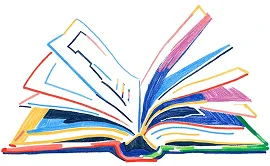Ressources humaines en hôtellerie de luxe : piloter le facteur humain pour garantir l'excellence

Dans l’hôtellerie de luxe, la qualité de service repose d’abord sur les femmes et les hommes qui la rendent possible. Les ressources humaines ne sont pas un simple support : elles sont le socle de l’expérience client.
Or, le secteur est confronté à une double tension :
- une pénurie structurelle de main-d’œuvre,
- une nécessité de réinventer la relation au travail pour attirer, fidéliser et faire grandir les talents.
Voici les leviers à maîtriser pour structurer une politique RH efficace et durable dans un établissement haut de gamme.
Déterminer les besoins en personnel : structurer avant de recruter
On parle souvent d’excellence, de qualité de service, de montée en gamme. Mais rares sont ceux qui commencent par poser la seule vraie question : avons-nous les moyens humains d’assurer ce que nous promettons ?
Dans l’hôtellerie de luxe, la prestation repose sur l’attention au détail, la fluidité d’exécution, la présence humaine au bon moment. Tout cela suppose une chose : la juste organisation des effectifs.
J’ai appris cette rigueur très tôt, lorsque je travaillais comme contrôleur de gestion au Four Seasons George V, à Paris. À l’époque, je collaborais avec chaque chef de service pour construire ce que nous appelions les staffing guides — ces outils qui traduisent les standards de service en équivalents temps plein. Il ne s’agissait pas seulement de faire des plannings : il fallait anticiper le besoin, poste par poste, jour après jour, pour garantir que les équipes soient dimensionnées à la réalité de l’activité.
Et puis, il y avait l’autre volet, tout aussi important : le contrôle de la planification réelle. Semaine après semaine, je passais au crible les emplois du temps. Mon rôle était d’identifier les écarts — sous-effectif, surcharge, dérive RH — afin d’alerter les responsables et de préserver l’équilibre économique autant que la cohérence du service.
Aujourd’hui, c’est exactement cette démarche que je déploie quand j’interviens dans un établissement en tant que consultant. Avant de parler de standards ou de culture, je commence toujours par regarder le socle organisationnel. Est-ce que les équipes sont taillées pour le niveau de service attendu ? Est-ce qu’il y a assez de monde dans les moments critiques ? Est-ce que les chefs de service disposent d’un outil clair pour piloter leur masse salariale… ou bien gèrent-ils « aux doigts mouillés » ?
Car c’est souvent là que le bât blesse. Je vois encore trop souvent des directions déçues de la qualité du service, mais qui n’ont jamais défini précisément combien de personnes il fallait pour délivrer ce service. Alors on exige l’inatteignable : une présence constante, une disponibilité parfaite… avec des équipes réduites à peau de chagrin. Et quand ça craque, on parle de “problèmes d’attitude”, de “manque d’implication” — alors que le problème était structurel.
Un staffing guide, ce n’est pas un outil Excel. C’est un acte de lucidité managériale. C’est ce qui permet de passer d’un service instable et dépendant des individualités, à un fonctionnement lisible, prévisible, maîtrisé. Cela implique de prendre en compte :
- les amplitudes d’ouverture,
- les pics d’activité,
- les règles légales (temps de repos, durée maximale…),
- les remplacements (absences, congés, formation).
Et surtout, cela donne une vision économique fiable : en rapportant le coût des équipes au chiffre d’affaires visé, on peut affiner la politique de pricing, ajuster le dimensionnement, ou réorienter les priorités.
Ce travail-là, je le considère comme un préalable indispensable à tout projet hôtelier ambitieux. Sans cette base, on navigue à vue. Et dans l’univers du luxe, l’improvisation ne pardonne pas longtemps.
Profils de poste : clarifier les attentes, responsabiliser les équipes
On parle souvent de performance, d’autonomie, d’évolution. Mais on oublie parfois que tout cela repose sur un outil simple, basique, mais fondamental : le profil de poste.
Trop souvent, il est perçu comme une formalité RH, un document figé quelque part entre deux classeurs. Pourtant, bien construit, il devient un levier stratégique pour la cohésion d’équipe, la qualité de service… et la progression individuelle.
Un profil de poste, ce n’est pas simplement une liste de missions. C’est un accord clair entre l’entreprise et le collaborateur sur ce qui est attendu, ce qui est proposé, et sur quoi s’appuiera l’évaluation.
Il y a, pour moi, deux dimensions clés à y faire figurer, sans jamais les confondre :
- Les attendus techniques : savoir-faire métier, compétences spécifiques, outils à maîtriser.
- Les attendus humains : posture, savoir-être, esprit d’équipe, maturité relationnelle.
Je me souviens très clairement, à mon arrivée comme directeur de la restauration au Bristol, à quel point il a été prioritaire pour moi de mettre à plat ces profils avec les chefs de service. On ne peut pas piloter une brigade de 80 personnes à l’intuition. Il faut que tout le monde parle le même langage.
Que veut-on dire exactement quand on attend de quelqu’un qu’il soit “exemplaire” ? Que signifie “prise d’initiative” sur un poste de demi-chef de rang ? Et surtout, comment évaluer cela objectivement, sans tomber dans la subjectivité ou le ressenti personnel ?
Au Peninsula, j’ai reproduit ce travail dès mon entrée en fonction. Là encore, la richesse et la complexité de l’organisation nécessitaient un socle commun. J’ai pris le temps, avec chaque chef de service, de revisiter chaque fiche : non pas pour remplir un dossier, mais pour créer un outil vivant, utilisable, parlant.
Et puis, il y a un autre enjeu, moins visible mais fondamental : la progression.
Un collaborateur qui souhaite évoluer a besoin d’un cap. Il doit pouvoir prendre la fiche du poste auquel il aspire, la lire, et se dire : “Voilà ce qu’on attend de moi à ce niveau. Voilà les compétences à acquérir. Voilà les qualités humaines à renforcer.”
C’est cette lisibilité qui donne du sens à l’effort, qui permet de se projeter, et qui installe une vraie culture de développement.
Dans certains établissements que j’accompagne aujourd’hui, je constate encore une absence totale de référentiel partagé. On évalue “au ressenti”, on recrute “au flair”. Cela peut fonctionner ponctuellement. Mais dans un contexte de tension sur les ressources humaines, c’est une fragilité majeure.
Un profil de poste bien conçu, c’est aussi ce qui vous permet, le jour où vous déléguez un recrutement, de le faire en confiance. Parce que la personne qui lit la fiche comprend ce qui est attendu techniquement, mais aussi ce qui fait la différence humainement.
Et cela, c’est non seulement un outil de gestion, mais un acte de clarté managériale. Un geste de respect envers les collaborateurs, qui savent où ils vont. Et un geste de lucidité pour l’organisation, qui s’offre les moyens de piloter, recruter, faire grandir avec cohérence.
Recrutement : construire un vivier de talents... et une image qui attire
Dans beaucoup d’établissements, on traite le recrutement comme un acte isolé. Une fiche de poste, une annonce, quelques entretiens. Et puis, parfois, une forme de déception : trop peu de candidatures, ou des profils qui ne correspondent pas à l’exigence de la maison.
Mais recruter dans l’hôtellerie de luxe, c’est tout sauf un réflexe administratif. C’est un travail de fond, de visibilité, de crédibilité — et d’attractivité réelle.
Un levier très puissant, souvent sous-estimé, c’est l’image que renvoie l’établissement. Pas celle qui figure sur le site internet, ni celle des campagnes de communication. Mais l’image véhiculée par celles et ceux qui y travaillent.
Quand un collaborateur parle fièrement de son poste à ses amis. Quand un ancien salarié dit « j’ai appris, j’ai grandi, j’ai aimé cette maison ». Quand un jeune en alternance raconte son stage comme une chance. Là, vous avez quelque chose d’exceptionnel. Un capital réputationnel qui ne s’achète pas. Qui se construit, au quotidien.
Un établissement qui veut attirer les talents doit d’abord se demander : est-ce que les gens qui y travaillent ont envie d’en parler autour d’eux ?
Pour moi, cette notion d’ambassadeur est centrale. C’est un axe de développement que je partage avec toutes les équipes RH que j’accompagne. Un employé engagé, bien traité, bien encadré, devient votre meilleur recruteur. Il recommande ses camarades d’école. Il parle de vous en bien après la saison. Il revient. Il vous fait revenir.
Mais il ne suffit pas d’être apprécié : il faut aussi être visible.
Et cette visibilité ne se résume pas à publier une annonce sur un job board. Il s’agit :
- d’être présent dans les écoles,
- de participer à des concours, des événements,
- de transmettre — ne serait-ce qu’un peu de son métier à ceux qui démarrent,
- et, bien sûr, d’exister sur les réseaux sociaux, avec une ligne éditoriale qui reflète ce que vous êtes vraiment.
C’est une démarche de fond, qui rejoint les logiques du marketing. On parle souvent de persona en marketing : ce profil-type du client qu’on souhaite attirer, avec ses envies, ses valeurs, ses canaux préférés.
👉 Le recrutement, aujourd’hui, c’est exactement cela.
Il faut savoir qui sont les talents que vous voulez faire venir : quelles écoles ils fréquentent, sur quels réseaux ils sont actifs, quels types de messages les mobilisent. Recruter un chef de partie qui sort de l’école Ferrandi ou une gouvernante expérimentée issue du terrain ne se fera pas avec les mêmes leviers, ni les mêmes mots.
Cela suppose de penser le recrutement comme une stratégie de présence et d’alignement, pas comme une urgence à combler.
Et dans ce contexte, la cooptation devient un outil précieux. Lorsque vous avez une équipe qui fonctionne bien, chaque départ peut ouvrir une opportunité : « Qui recommanderiez-vous ? Avec qui aimeriez-vous retravailler ? »
C’est particulièrement vrai en fin de saison : un employé qui part dans un autre établissement peut, s’il a vécu une expérience forte chez vous, porter votre nom avec fierté, et attirer demain d’autres profils similaires.
Recruter, c’est donc semer. Semer dans les écoles, dans les réseaux, dans les têtes et dans les parcours. Et récolter plus tard, au moment où les talents cherchent une maison où poser leurs valises.
Intégration : accueillir n’est pas une formalité
On pense parfois que le plus dur est de recruter. C’est faux. Le plus dur — et le plus décisif — c’est ce qui se passe dans les premières heures, les premiers jours, les premières semaines.
Car c’est là que tout se joue. La motivation, la compréhension des attentes, l’adhésion à la culture de la maison, ou au contraire… l’envie de repartir dès que possible.
Je me souviens parfaitement de l’intégration que j’ai vécue — ou plutôt, que j’ai observée — au Four Seasons George V. C’est, à ce jour, l’une des plus puissantes démonstrations de ce que peut être une intégration réussie.
Tout commence par deux jours de formation interne, totalement dédiés à l’accueil des nouveaux collaborateurs. Pas pour les faire signer des papiers. Pour leur transmettre une culture. On parle symbolique, valeurs, fierté d’appartenance. On écoute des formateurs internes — pas des prestataires — expliquer pourquoi on travaille ici, ce que ça représente, ce qu’on attend de chacun.
Ensuite, chaque nouvel employé est accompagné par un mentor. Pas un collègue désigné par hasard, mais une personne formée à cela, avec une checklist claire : lieux à visiter, procédures à assimiler, contacts à connaître.
Et puis, quelques semaines plus tard, nouvelle formation. Cette fois-ci, on fait le point : comment l’intégration se passe-t-elle ? Qu’est-ce qui est clair, qu’est-ce qui l’est moins ? On ouvre un espace pour poser des questions, partager des doutes, proposer des ajustements.
Enfin — et c’est là toute l’élégance du dispositif — le cycle se termine par une immersion client. Le nouveau collaborateur dîne dans les restaurants, profite du spa, dort à l’hôtel, prend son petit-déjeuner. Il vit l’expérience comme un client, pour comprendre ce qu’on attend de lui, dans le moindre détail.
Il comprend l’impact de chaque geste. Il se met dans la peau de celui pour qui on travaille vraiment.
C’est brillant, parce que c’est cohérent. On ne demande pas d’incarner un service cinq étoiles à quelqu’un qui n’a jamais vu ni ressenti ce service.
Je compare souvent l’intégration à l’accueil à la maison.
Quand vous recevez quelqu’un chez vous, vous ne lui dites pas simplement “fais comme chez toi” en espérant que ça suffira.
Non : vous lui montrez la salle de bain, vous lui expliquez s’il faut enlever ses chaussures ou pas, vous lui proposez à boire, vous lui présentez les autres invités.
Bref : vous posez les règles du jeu. Les visibles et les invisibles.
Et dans une entreprise, c’est exactement ça : il faut aider le nouvel employé à comprendre ce qui est attendu, ce qui est encouragé, ce qui est valorisé… mais aussi ce qui ne l’est pas. Ce qui fait partie du cadre, et ce qui relève de la culture implicite.
Qui est qui. Comment on se parle. Quels sont les rituels. Comment on résout les conflits. Où on peut poser des questions sans être jugé.
Cette intégration doit être structurée, mais aussi incarnée par des personnes de confiance. Elle doit mêler la rigueur des informations (contrats, outils, procédures) et la chaleur de la transmission humaine.
Et surtout, elle doit inclure un espace d’expression, où chaque nouvel arrivant peut parler de ses doutes, de ses incompréhensions, mais aussi de ce qu’il apprécie.
Parce qu’un collaborateur bien intégré, ce n’est pas juste quelqu’un qui sait quoi faire. C’est quelqu’un qui a envie de bien faire, parce qu’il comprend pourquoi, avec qui, et comment.
Succession Plan : anticiper, faire grandir, sécuriser
Dans un hôtel ou un restaurant, tout tourne vite. Les saisons, les départs, les ouvertures, les tensions du quotidien… Et dans ce rythme effréné, on oublie parfois une chose essentielle : personne n’est éternel à son poste.
Un manager qui part du jour au lendemain, c’est une équipe qui tangue, des décisions qui se figent, une culture qui s’étiole. Et c’est d’autant plus vrai quand personne n’a été préparé à prendre la relève.
C’est pour cela que je suis convaincu — et je le répète dans chaque mission de mentorat ou de conseil — qu’il faut toujours avoir un plan de succession en place.
Un plan clair, structuré, vivant. Pas un fichier oublié dans un dossier RH, mais un véritable levier de développement interne.
Je recommande que chaque poste de management ait, en permanence, une personne identifiée en formation pour pouvoir prendre le relais.
Pas uniquement pour prévoir un départ : pour créer de l’agilité, de la projection, et de la responsabilité partagée.
Quand j’ai posé ma démission du Bristol, je n’ai pas simplement rendu mes clefs.
J’ai proposé un organigramme complet de succession, avec :
- mon propre remplaçant,
- la personne en capacité de remplacer ce remplaçant,
- et une vision claire des implications RH, opérationnelles et humaines.
Ce n’était pas un luxe. C’était une responsabilité de transmission.
Et c’est ce qui a permis à l’équipe de rester stable, de progresser, de continuer à délivrer l’excellence malgré mon départ.
C’est aussi ce qui a permis à la direction d’éviter l’urgence, de prendre des décisions sereines, de conserver son cap.
Anticiper, ce n’est pas avoir peur de perdre. C’est donner les moyens à l’organisation de rester forte, quoi qu’il arrive.
Mais ce plan de succession ne fonctionne que si les personnes concernées sont au courant qu’elles en font partie.
Cela peut sembler évident. Ça ne l’est pas toujours.
Il faut leur dire : « Tu es dans la ligne pour évoluer vers ce poste. Voilà pourquoi. Voilà ce qu’on attend. Voilà le chemin pour y arriver. Est-ce que tu en as envie ? »
Et là, un vrai dialogue s’ouvre. Car une succession imposée, non désirée, peut devenir un échec.
Une succession choisie, préparée, clarifiée, devient un levier d’engagement très fort.
Ce processus de montée en compétence a aussi un impact immédiat sur les managers en poste.
Savoir que quelqu’un est formé pour prendre le relais, c’est :
- se permettre de déléguer davantage,
- prendre de la hauteur,
- transmettre ce qu’on sait,
- se concentrer sur des missions plus stratégiques.
Et pour celui qui apprend, c’est une occasion rare d’expérimenter, d’oser, de sortir de sa zone de confort tout en étant soutenu.
Un bon Succession Plan, ce n’est donc pas un simple backup. C’est un outil de croissance et de responsabilisation mutuelle.
C’est une manière de dire à chacun : « Tu fais partie de l’avenir de cette maison. Et on s’organise pour que tu y trouves ta place. »
Faire évoluer : reconnaître, accompagner, retenir
On parle beaucoup de formation dans notre secteur. Trop souvent comme d’une ligne budgétaire. Trop rarement comme d’un levier stratégique.
Et pourtant, c’est un marqueur fort de la culture d’entreprise : on sait exactement ce qu’une maison pense de ses équipes quand on regarde comment elle forme, à quoi, et avec quel objectif.
La formation utile, ce n’est pas celle qu’on cale entre deux services ou qu’on commande par habitude. C’est celle qui répond à un besoin précis, qui s’inscrit dans une vision de progression, à la fois individuelle et collective.
Un directeur de département, un directeur d’hôtel, un propriétaire a tout intérêt à planifier une ou deux formations par an. Pas pour cocher une case. Mais pour prendre un temps de recul :
- Quelles sont les compétences clés à faire monter cette année ?
- Quels sont les enjeux stratégiques de l’établissement ?
- Quels sont les freins observés au quotidien ?
- Quelle posture attend-on de nos managers demain ?
Et c’est là qu’intervient la responsabilité managériale : je crois profondément que le premier formateur d’une équipe, c’est son N+1.
C’est lui qui donne les clés du métier au quotidien. C’est lui qui montre l’exemple, qui recadre, qui valorise, qui transmet. La compétence opérationnelle se construit dans l’action. C’est une évidence.
Mais il y a aussi ce qu’on ne peut pas apprendre seul.
Les langues, l’informatique, l’intelligence artificielle, les nouveaux outils de pilotage, les méthodes de service innovantes… Voilà des champs où un intervenant extérieur, compétent, va accélérer la montée en compétence et ouvrir des horizons.
Et puis il y a autre chose. Quelque chose que je vois chaque jour dans mes accompagnements, et qui transforme les organisations : le coaching professionnel.
Un manager, un directeur, un chef de service… Ce sont des personnes exposées, engagées, parfois isolées dans leur fonction.
Et ce qu’il leur manque, ce n’est pas forcément une compétence technique. C’est un espace pour réfléchir, tester, ajuster, respirer.
Un espace confidentiel et sécurisé, pour :
- déposer leurs difficultés,
- prototyper de nouvelles postures,
- oser dire,
- oser faire,
- oser devenir.
C’est ce que je propose dans mes coachings individuels.
Et c’est aussi ce que je vois émerger dans les coachings d’équipe : un vrai changement dans la manière de travailler ensemble. On sort du “chacun dans sa case”, et on entre dans la coopération vivante.
Bien sûr, tout cela a un coût. Mais il existe des leviers financiers sous-estimés :
👉 Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, vous cotisez déjà à un Opérateur de Compétences (OPCO). Vous pouvez donc mobiliser un budget pour former vos équipes, y compris sur des sujets comme le management ou la relation client.
👉 Si vous êtes plus de 50, vous pouvez structurer un budget formation annuel, aligné sur vos priorités stratégiques. Le tout est de ne pas faire “de la formation pour faire de la formation”, mais de la formation qui sert votre vision.
Une formation bien pensée, ce n’est pas une dépense. C’est un acte d’engagement. Une preuve de confiance. Et un levier de rétention.
Car on oublie souvent que les talents ne quittent pas leur métier : ils quittent un contexte.
Et ce contexte, on le construit aussi par ce qu’on choisit de transmettre, de développer, de soutenir.
Conclusion – Le luxe de l’intention
Dans l’hôtellerie haut de gamme, chaque geste compte.
Le pli d’un drap. Le regard échangé à l’accueil. Le silence d’un service fluide.
Mais ce niveau d’exigence ne peut pas reposer sur l’improvisation. Il demande une organisation claire, des rôles bien définis, une culture commune et des équipes qui savent pourquoi elles font ce qu’elles font.
Ressources humaines, ce n’est pas un “support”.
C’est une colonne vertébrale. Une boussole stratégique. Un levier de différenciation dans un secteur où l’expérience humaine est au cœur de tout.
Ce que je transmets dans mes accompagnements, ce que j’observe chaque jour sur le terrain, c’est que les plus belles maisons sont celles qui prennent soin de leurs équipes avec la même élégance que celle qu’elles offrent à leurs clients.
Elles prévoient, elles écoutent, elles forment, elles corrigent, elles anticipent.
Et surtout, elles le font avec intention.
Vous n’avez pas besoin de tout transformer. Mais peut-être de faire un pas de côté.
Regarder comment vos équipes sont organisées, comment elles vivent le quotidien, comment elles évoluent.
Et si besoin, vous faire accompagner pour structurer, clarifier, renforcer.
Diriger, ce n’est pas tout faire. C’est créer les conditions pour que les bonnes choses se fassent.
Si cet article fait écho à ce que vous vivez aujourd’hui dans votre établissement, je vous invite à en discuter.
👉 Vous pouvez réserver un appel directement ici : Voir mes créneaux disponibles
Je travaille aux côtés de dirigeants et de DRH qui veulent allier excellence opérationnelle et justesse humaine. Ensemble, nous trouvons des solutions concrètes, adaptées à vos enjeux, et résolument orientées vers l’impact.
À bientôt peut-être.
Et d’ici là : prenez soin de vos équipes — elles sont votre première richesse.



Article Hospitality On
Vous souhaitez un accompagnement sur-mesure à la hauteur de vos ambitions ?
Prendre un rendez-vous